Malgache
Le malgache (autonyme : ) est la langue nationale et l'une des langues officielles de Madagascar. C'est une langue normalisée, principalement dérivée du dialecte parlé sur les hautes terres centrales. Elle est la plus occidentale des langues malayo-polynésiennes et donc des langues austronésiennes. Plus précisément, elle appartient au rameau dit « Grand Barito », dont les langues sont parlées à Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo, dans l'actuelle région de Banjarmasin, et comprennent notamment le ma'anyan, le samihim, le dusun deyah, mais aussi par des populations surnommées « nomades de la mer », les Bajau. Dans cette région, la langue dominante est aujourd'hui le malais, qui appartient à un autre rameau malayo-polynésien. Le malgache est également parlé à Mayotte sous le nom de kibushi (shibushi en mahorais) dans une vingtaine de villages.
Le malgache fait partie d'un ensemble linguistique comprenant plus d'une vingtaine de « variantes » locales, qualifiées habituellement de « dialectes ».
Sur le plan lexical, plus de 90 % du vocabulaire traditionnel de la langue malgache dont on peut identifier la filiation remonte à des origines austronésiennes. Le reste est d'origine bantou, arabo-swahili ou sanskrite. Et encore, ces derniers mots, totalisant pour chaque groupe quelques dizaines d'éléments à peine, sont en général cantonnés à des domaines d'activités particuliers. Ainsi les mots d'origine bantou se retrouvent surtout dans le domaine de l'élevage (tels que omby, ondry, akoho) et ceux swahilis celui de certains objets commerciaux, du calendrier et de la divination (alahady, adaoro, sikidy, etc.). Les plus anciens emprunts semblent ceux d'origine sanskrite à travers le malais (tsara, soa, sahaza, sandry, sisa, hetsy), remontant vraisemblablement au voisinage avec les navigateurs malais au cours du premier millénaire. Ce sont en effet les peuples malayophones qui, en Asie du Sud-Est ont été les premiers à subir l'influence des cultures indiennes.
L'écriture moderne de la langue malgache en alphabet latin fut fixée par décret le, à la suite d'une concertation entre le roi Radama et les missionnaires britanniques qui venaient d'introduire l'imprimerie dans le royaume. Le principe retenu fut alors que les consonnes devaient s'écrire comme en anglais et les voyelles comme en italien. Auparavant, quelques lettrés du royaume utilisaient déjà l'alphabet arabe (sora-be ou « Noble écriture ») développé dans le sud-est de l'île.
Le fait que la langue malgache soit originaire d'Indonésie ne doit néanmoins pas faire hâtivement conclure que son ancêtre était ou s'écrivait comme le vieux-malais avec un alphabet de type indien.
La langue malgache possède un vocabulaire très riche (certains dictionnaires malgaches possèdent en effet plus de soixante mille mots). La richesse du vocabulaire la rend propre à exprimer avec précision les choses abstraites, la poésie et l'image. Le problème majeur de la langue malgache est qu'elle a un vocabulaire très restreint en ce qui concerne la science et les techniques.
Depuis le, la langue malgache a emprunté un nombre considérable de mots aux langues européennes, en particulier le français et l'anglais, comme latabatra (table), seza (chaise), birao (bureau), tarigetra (de l'anglais target), sekoly (de l'anglais school).
Dans l'aspect actuel de l'orthographe, qui comporte 21 lettres (à savoir les 26 lettres standards de l’alphabet latin moins le c, le q, le w, le u et le x), le o se prononce comme le « ou » français (encore que dans certaines régions, notamment dans les régions côtières — nord, nord-ouest, ouest... et pas que dans les campagnes —, il puisse aussi se prononcer comme en français). En revanche, la diphtongue ao tend à se prononcer comme un simple o. Le i se trouvant à la fin de chaque mot s’écrit toujours y lequel est quasiment muet. Le e est prononcé comme un é français. Pour les consonnes, le tr et le dr représentent des alvéolaires affriquées, proches du « tram » et du « » de l'anglais, avec davantage d'insistance sur le r qui est toujours roulé, comme en italien. Le g est dur, comme dans « gare ». Le s, est toujours sourd (comme le ss en français), et légèrement chuinté. Le ts se prononce comme dans « tsigane ».
L'accent tonique tombe en général sur l'avant-dernière syllabe du mot, à moins que celui-ci ne se termine en -ka, -tra, ou -na, auquel cas l'accent tombe sur l'antépénultième. Les voyelles inaccentuées se trouvant à la fin de chaque mot sont à peine prononcées.
Le malgache fait partie d'un ensemble linguistique comprenant plus d'une vingtaine de « variantes » locales, qualifiées habituellement de « dialectes ».
Sur le plan lexical, plus de 90 % du vocabulaire traditionnel de la langue malgache dont on peut identifier la filiation remonte à des origines austronésiennes. Le reste est d'origine bantou, arabo-swahili ou sanskrite. Et encore, ces derniers mots, totalisant pour chaque groupe quelques dizaines d'éléments à peine, sont en général cantonnés à des domaines d'activités particuliers. Ainsi les mots d'origine bantou se retrouvent surtout dans le domaine de l'élevage (tels que omby, ondry, akoho) et ceux swahilis celui de certains objets commerciaux, du calendrier et de la divination (alahady, adaoro, sikidy, etc.). Les plus anciens emprunts semblent ceux d'origine sanskrite à travers le malais (tsara, soa, sahaza, sandry, sisa, hetsy), remontant vraisemblablement au voisinage avec les navigateurs malais au cours du premier millénaire. Ce sont en effet les peuples malayophones qui, en Asie du Sud-Est ont été les premiers à subir l'influence des cultures indiennes.
L'écriture moderne de la langue malgache en alphabet latin fut fixée par décret le, à la suite d'une concertation entre le roi Radama et les missionnaires britanniques qui venaient d'introduire l'imprimerie dans le royaume. Le principe retenu fut alors que les consonnes devaient s'écrire comme en anglais et les voyelles comme en italien. Auparavant, quelques lettrés du royaume utilisaient déjà l'alphabet arabe (sora-be ou « Noble écriture ») développé dans le sud-est de l'île.
Le fait que la langue malgache soit originaire d'Indonésie ne doit néanmoins pas faire hâtivement conclure que son ancêtre était ou s'écrivait comme le vieux-malais avec un alphabet de type indien.
La langue malgache possède un vocabulaire très riche (certains dictionnaires malgaches possèdent en effet plus de soixante mille mots). La richesse du vocabulaire la rend propre à exprimer avec précision les choses abstraites, la poésie et l'image. Le problème majeur de la langue malgache est qu'elle a un vocabulaire très restreint en ce qui concerne la science et les techniques.
Depuis le, la langue malgache a emprunté un nombre considérable de mots aux langues européennes, en particulier le français et l'anglais, comme latabatra (table), seza (chaise), birao (bureau), tarigetra (de l'anglais target), sekoly (de l'anglais school).
Dans l'aspect actuel de l'orthographe, qui comporte 21 lettres (à savoir les 26 lettres standards de l’alphabet latin moins le c, le q, le w, le u et le x), le o se prononce comme le « ou » français (encore que dans certaines régions, notamment dans les régions côtières — nord, nord-ouest, ouest... et pas que dans les campagnes —, il puisse aussi se prononcer comme en français). En revanche, la diphtongue ao tend à se prononcer comme un simple o. Le i se trouvant à la fin de chaque mot s’écrit toujours y lequel est quasiment muet. Le e est prononcé comme un é français. Pour les consonnes, le tr et le dr représentent des alvéolaires affriquées, proches du « tram » et du « » de l'anglais, avec davantage d'insistance sur le r qui est toujours roulé, comme en italien. Le g est dur, comme dans « gare ». Le s, est toujours sourd (comme le ss en français), et légèrement chuinté. Le ts se prononce comme dans « tsigane ».
L'accent tonique tombe en général sur l'avant-dernière syllabe du mot, à moins que celui-ci ne se termine en -ka, -tra, ou -na, auquel cas l'accent tombe sur l'antépénultième. Les voyelles inaccentuées se trouvant à la fin de chaque mot sont à peine prononcées.
Pays
-
Madagascar
Madagascar (Madagasikara), en forme longue (Repoblikan'i Madagasikara), est un État insulaire situé dans l'Océan Indien et géographiquement rattaché au continent africain, dont il est séparé par le canal du Mozambique. C’est la quatrième plus grande île du monde après le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Longue de 1580 km et large de 580 km, Madagascar couvre une superficie de 587000 km. Sa capitale est Antananarivo et le pays a pour monnaie l'ariary. Ses habitants, les Malgaches, sont un peuple associant un mélange de populations d'origines austronésiennes et est-africaines, mais parlant une langue malayo-polynésienne : le malgache. Le pays est entouré par d'autres îles et archipels dont la Réunion, Maurice, les Comores (dont Mayotte) et les Seychelles.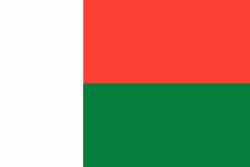
Durant la majeure partie du, l'île est administrée par le royaume de Madagascar, cette administration s'exerce dans le cadre du protectorat français de Madagascar après 1883, à la suite de la première expédition de Madagascar. Considérant que le protectorat est peu appliqué par le gouvernement malgache, la France organise une deuxième expédition militaire à partir de 1895. Les établissements français de Diego-Suarez, de Nosy Be et de l'Île Sainte-Marie sont rattachés au protectorat le. Les troubles consécutifs à l'intervention militaire française conduiront, en 1897, à la fin de l'autonomie malgache, à l'annexion de l'île par la France et à la réunion de l'ancien protectorat et d'autres territoires français au sein de la colonie de Madagascar et dépendances. Le premier gouvernement autonome malgache revoit le jour le lorsque la république de Madagascar est proclamée sur le territoire de l'ancien protectorat (territoire de l'ancien Royaume mérina et des anciens établissements français de Diego-Suarez, de Nosy Be et de l'île Sainte-Marie) tout en restant membre de la Communauté française. En 1960, la République malgache accède à l'indépendance, ce qui fait du pays l'un des premiers à devenir souverain dans cette zone de l'océan Indien.
